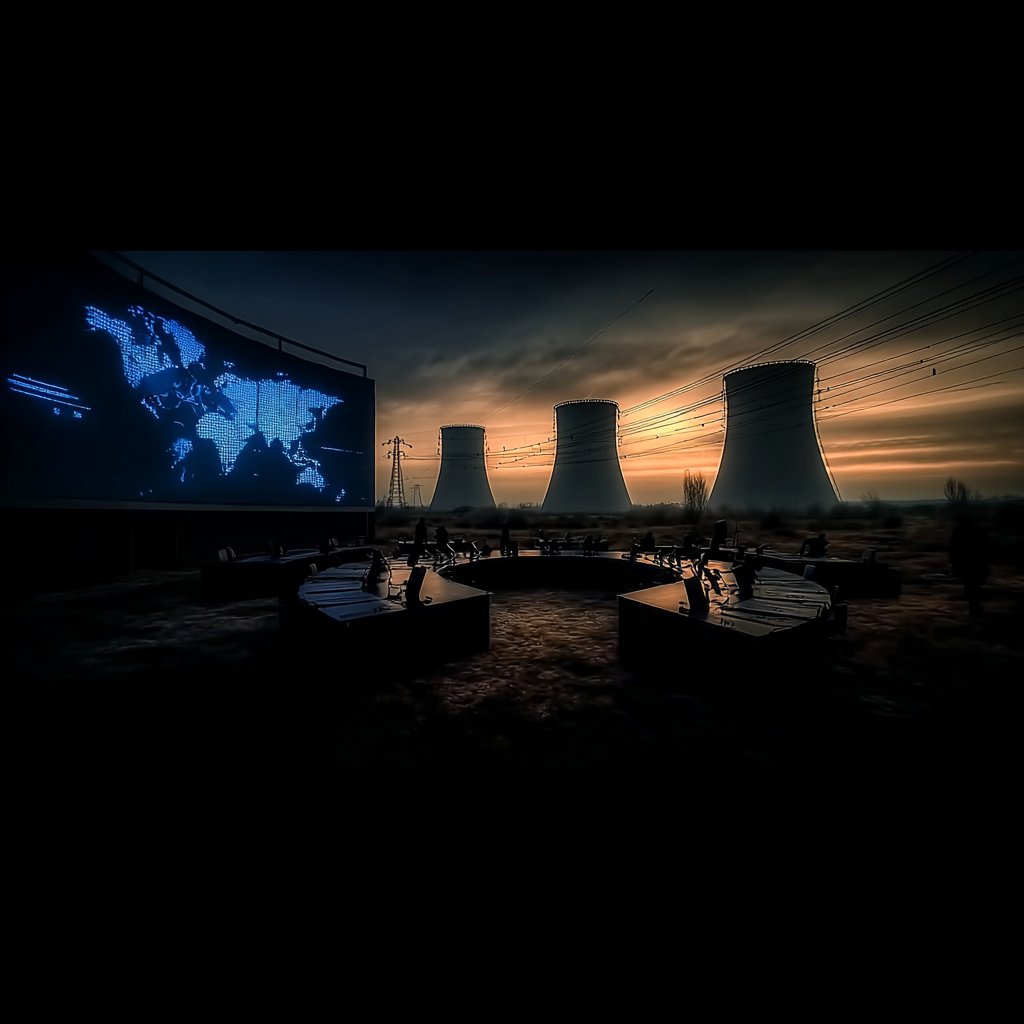Accueil Effisyn S.D.S
Perte de souveraineté énergétique française – Chronique d’une incurie politique
La vision Gaulliste de l’indépendance énergétique
Il convient de reprendre la vision géostratégique du général de Gaulle, qui revient au pouvoir en juin 1958 après la crise d’Alger et la création du Comité de salut public en mai de la même année. En octobre 1958, le projet de Constitution est adopté, donnant naissance à la Ve République. Le 6 août 1958, le général de Gaulle visite le site nucléaire de Marcoule [INA] et s’enthousiasme pour les progrès obtenus depuis la création de l’industrie nucléaire en 1945. Dès les débuts, il souhaite créer une filière puissante afin de servir nos intérêts économiques civils et, bien sûr, affirmer la capacité de dissuasion nucléaire — un atout qui, encore à ce jour, malgré le déclin, confère encore une certaine influence à la France sur la scène internationale. Certains responsables, pourtant chargés de leurs fonctions (politiques ou haute administration), semblent prêts à sacrifier cet avantage.
Pour le nucléaire civil l’objectif de l’époque était d’atteindre 80% de la production d’électricité par le nucléaire d’ici les années 1990. Cet objectif était quasi atteint, car nous étions à cette époque entre 75% et 76%. Cette part s’est réduite aujourd’hui à 67% (2024), notamment par la décision aberrante de réduire la part du nucléaire à 50 % prise en 2014 par François Hollande pour satisfaire ses alliés écologistes [World Nuclear Association].
Cette stratégie initiale s’appuyait aussi sur la production d’électricité hydraulique, qui est une électricité renouvelable pilotable contrairement à l’éolien et au photovoltaïque [Smartrezo – Savoie et Haute-Savoie que d’énergie]. Le repère historique majeur ici c’est la loi du 19 février 1919 promulguée par Clemenceau et qui demeure encore aujourd’hui une référence pour ce qui est de l’organisation de la filière hydro-électrique. De Gaulle s’est appuyé sur cette filière et a permis son renforcement grâce à la création du Commissariat à l’énergie hydraulique (CEH) et permis ainsi le développement des grands barrages Alpins et Pyrénéens (Serre-Ponçon 1961 et Monteynard 1965 par exemple). A cette époque la part de l’hydro-électrique dans le mix énergétique français frôlait les 30 %. Pour De Gaulle, le nucléaire et l’hydro-électricité étaient les deux piliers de notre souveraineté
Ces investissements visionnaires de De Gaulle ont assuré une électricité peu chère pendant plusieurs décennies, offrant à nos entreprises un avantage compétitif considérable, même si la rentabilité a ensuite été affectée par une fiscalité désavantageuse. Les ménages en ont également bénéficié grâce à l’électrification du chauffage domestique, ce qui a contribué à contenir l’inflation du coût de l’énergie lors des deux chocs pétroliers.
La trahison de l’intérieur
À la sortie des années 1970, grâce à la vision stratégique de De Gaulle sur notre indépendance énergétique, continuée sous l’ère Pompidou et Giscard d’Estaing, nous avions une industrie florissante source d’excédents commerciaux et d’un vivier de compétences techniques précieuses.
Mais il faut être honnête : les premiers coups de frein sur notre filière électro‑nucléaire, même si la gestion d’entreprises publiques comme EDF n’était pas exempte de critiques, sont venus principalement des écologistes. Dans les années 1970‑1980, la méfiance envers le nucléaire se manifestait sous deux angles : un angle pacifiste, opposé au nucléaire militaire, et un angle civil, centré sur la problématique des déchets, qui demeure d’actualité. Cette opposition a entraîné des retards dans la construction de nouvelles centrales, comme la centrale Bugey 2 dans l’Ain, ainsi que la suspension du programme Mesmer de 1974…
Plus récemment les écologistes ont imposés par des accords politiques la fermeture contre-productive de la centrale de Fessenheim, avec des conséquences économiques et sociales que l’on préfère ne pas évoquer… Dans ce dernier dossier, le rôle de l’Allemagne n’était pas négligeable non plus. Parmi les écologistes, mentionnons une personnalité politique particulièrement nuisible et malveillante qui a commis selon mon humble avis un acte de haute trahison, il s’agit de Dominique Voinet, Ministre de l’environnement de 1997-2001, qui a mis fin au programme Super-Phénix (1997), prototype de 4e génération qui aurait pu permettre de résoudre en partie le problème des déchets. A cette époque la France avait des longueurs d’avances technologiques sur ses concurrents, avantages dont nous payons encore les conséquences de la disparition. Il y a bien eu une tentative de relance de cette filière (réacteur Astrid) mais celle-ci a été étouffée par Emmanuel Macron. Maintenant l’histoire se passe en Chine où ils vont mettre en place de tels réacteurs [(1)Forum Nucléaire Suisse (2) Média24].
La deuxième « trahison » attribuée à Dominique Voinet, dont elle s’est même vantée dans une interview, s’est produite lors des pourparlers de 2000‑2001 à Bruxelles dans le cadre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) lié à l’accord de Kyoto. Elle a orchestré avec son homologue Anglais, le blocage du droit de la filière nucléaire à bénéficier de crédits carbone, ce qui l’a clairement défavoriser contre les ENR non pilotables. Cette manœuvre a été décrite à juste titre comme un sabotage diplomatique dans un documentaire de 2003 [(1)Europe1 – (2) Documentaire]. Ses actions passées rendent d’autant plus incompréhensible sa nomination au Haut Comité pour la Transparence et l’Information sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) en 2023. Sa place serait plutôt derrière les barreaux. Quels dégâts va-t-elle encore pouvoir perpétrer ?
Rôle de l’Europe dans la libéralisation du marché de l’énergie et la complicité de l’Allemagne dans la sape de la filière nucléaire française
Nous sommes en 1998, La première phase de la libéralisation du marché de l’énergie [europa.ue] s’engage avec la création d’un marché intérieur de l’énergie européen qui impose l’ouverture du gaz et de l’électricité à la concurrence. Les fournisseurs d’énergie doivent offrir leurs tarifs de façon transparente et non discriminatoire (Premier Paquet énergie 1996-1998).
Vient ensuite la Directive 2019/944 (marché de l’électricité) et le Règlement 2019/943, qui ont renforcé les droits des consommateurs, introduit des mécanismes de capacité et prévu une surveillance accrue des tarifs afin d’éviter les abus de monopole [Le Monde].
Cette évolution met la France, qui doit moderniser son parc nucléaire, en tension avec les intérêts allemands. Car l’Allemagne depuis le Tsunami de Fukushima (2011) a déclenché une sortie précipité et totale du nucléaire . Elle favorise les énergies renouvelables intermittentes comme l’éolien et non-pilotables qui doivent être associées à une autre énergie, en l’occurrence aux centrales à gaz. Elle a décidé de compter sur le gaz russe, dépendance qui leur a été fatale au déclenchement de la guerre d’Ukraine par Poutine L’Allemagne pratique aussi un lobbying décomplexé et agressif dont nous avons été témoins à l’occasion d’un rapprochement entre nos ministères de l’environnement. A l’intérieur même du ministère français, des fondations et think-tanks allemands notamment Stiftung Umwelt und Entwicklung et Bundesverband der Energie-und Umwelt – Stifungen) finançaient, financent peut-être encore, des études et missions de conseil aux Haut-Fonctionnaires français. Berlin présente les bénéfices d’une transition basée sur le binôme renouvelable-gaz, favorable à l’industrie allemande et prône l’abandon du nucléaire. Ces actions ont été mentionnées dans la question parlementaire E-002175/2023 déposée auprès de la commission du parlement européen qui signale explicitement le lobbying anti-nucléaire à l’encontre de la France et de la Pologne.
En parallèle la libéralisation européenne du marché de l’énergie a obligé à casser l’outil industriel performant que la France avait construit. En 2000 la France a du séparer RTE (Réseau de Transport de l’Électricité) d’EDF, dans l’objectif imposé par l’Europe de garantir un accès non-discriminatoire au réseau [Springer]. Le but est d’empêcher un monopole vertical qui freinerait la concurrence, la perte du segment de transport a réduit de facto la capacité d’EDF à financer de lourds investissements sans l’aide de l’état, avec des impacts sur la compétitivité. Cela plus les manœuvres allemandes pour éliminer du green deal l’énergie nucléaire et faire passer les centrales à gaz comme « green » n’ont fait qu’affaiblir la filière française d’excellence. Autre conséquence et pas des moindres, EDF s’est vu imposé de vendre une partie de sa capacité de production nucléaire à ses concurrents via l’ARENH (Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique) à un prix très désavantageux. Ajoutons à cela la complexité des mécanismes et l’apparition de concurrents qui ne sont finalement que des « traders » et non des producteurs et la facture électrique des ménages et des entreprises français a fini par exploser. Mais réjouissons-nous, tout n’est pas sombre, ce qui provoque des faillites en France aide à soutenir l’industrie allemande qui peut ainsi plus facilement nous concurrencer.
Compte tenu de la nature de l’électricité un bien non stockable, on peut légitimement penser que la libéralisation à marche forcée du marché de l’électricité européen est une démarche très idéologisée qui a fait l’impasse sur la réalité technique et fonctionnelle dudit marché. On pourrait considérer que cette vision idéologique est constamment tempérée par des mécanismes de régulation conçus pour protéger la stabilité du système électrique et des intérêts européens. La croyance idéologique que la concurrence entraîne une baisse des prix se trouve invalidée dans le cas du marché de l’électricité compte tenu de ses spécificités. En effet la libéralisation a fait exploser les prix nécessitant la mise en place de protections publiques pour en limiter les impacts sur le pouvoir d’achat et de préserver très partiellement la compétitivité de nos entreprises.
Retard d’investissements qui induisent des risques sur la stabilité de l’approvisionnement mais aussi des prix.
On ne peut pas faire porter la responsabilité actuelle du désastre énergétique que sur l’Europe et sa marche forcée vers la libéralisation. Le système des grandes entreprises publiques, EDF, Areva, Framatome etc de la filière électrique et nucléaire a montré ses limites, notamment par l’endogamie des équipes dirigeantes de ces grands groupes et du confort excessif que produit le fait d’être en position de monopole.
Avant la libéralisation, les capacités de production et de transport étaient suffisantes, puisqu’il y avait peu d’exportation et d’importation. Avec la libéralisation les besoins ont augmenté au niveau européen, le manque d’investissement dans les infrastructures de production (nouvelles tranches nucléaires) ou de stratégie de stockage (batteries et STEP (Stations de Transfert d’Énergie par Pompage-Turbinage)) qui est nécessaire lorsqu’on augmente la production via les ENR non-pilotables, clairement fragilise notre situation par ces contraintes extérieures à notre modèle initial. Les investissements nouveaux notamment l’EPR avec des surcoûts massifs et des retards tout aussi pénalisants ont obéré nos capacités de production. Les messages politiques hostiles au nucléaire, portés par les écologistes, ainsi que les orientations prises sous les présidences de François Hollande et du premier mandat d’Emmanuel Macron, ont découragé les jeunes ingénieurs issus des grandes écoles de s’engager dans cette filière. Cette situation rend difficile pour les exploitants de conserver les compétences nécessaires à leurs activités. Se constituer un pôle de compétences reconnues internationalement ne se fait pas en un claquement de doigts mais sa destruction oui.
Merci messieurs Hollande et Macron. Le revirement de ce dernier sur le sujet ne le dédouanera pas des dégâts faits : affaire Alstom (turbines Arabelles – Le Piège Américain de Frédéric Pierucci), arrêt de Fessenheim, arrêt du projet Astride [Reuters] cette décision a gâché 735M€ d’investissements publics [Le Figaro, 25 octobre 2019], etc.
Tensions géopolitiques et impacts sur le prix de l’énergie
Dans les paragraphes précédents, j’ai insisté sur les responsabilités individuelles de nos dirigeants par leur manque d’anticipation, de courage, leurs intérêts économiques ou idéologiques personnels. On ne peut cependant pas exclure les impacts de la nouvelle situation géopolitique instable. Tout d’abord par la guerre d’ukraine déclenchée par Poutine, qui a provoqué la flambée des prix du gaz avec un impact important sur l’économie européenne due à la dépendance notamment allemande à 80 % environ au gaz russe. Nous avons été impactés de façon non-négligeable aussi en des règles du marché européen qui imposent un coût de l’énergie lié à la dernière centrale à gaz mise en production (mécanisme mis en place pour ne pas défavoriser les nouveaux investissements des et réduire l’avantage français lié au nucléaire). Ceci est lié à la structure de production électrique allemande. Nous aurions pu comme les espagnols ou portugais prendre la décision de sortir des règles temporairement de ce marché, ce qui n’a pas été fait.
Conclusions
Cet article présente une opinion personnelle, mais je m’appuie sur un certain nombre de faits établis, ainsi que des faisceaux d’indices concordants. Certain objecterons que la réduction du nucléaire était nécessaire pour répondre aux exigences climatiques, ce qui fait débat y compris chez des écologistes non dogmatiques qui comprennent que l’objectif de décarbonation est crucial et que le nucléaire est une des forces du mix énergétique français. Suite à l’abandon Allemand du nucléaire, on voit bien que leurs émissions de carbone sont plus fortes qu’en France, de par leurs choix ENR+Gaz [(1)WorldOmeter / (2)Cleanenergywire].
La responsabilité de nombreux dirigeants politiques français dans la situation actuelle et dans la de perte de souveraineté que nous subissons est indéniable. Même si des éléments géopolitiques permettent d’expliquer une part des difficultés, l’ampleur de celles-ci sont bien dues à un manque d’anticipation, de vision et de courage politique. Les dernières rumeurs concernant le passage en force d’un ou plusieurs décrets sur la PPE3, sont inquiétantes. L’objectif du gouvernement serait de fournir un cadre stable pour l’investissement dans les ENRs non pilotables, en s’engageant à racheter s à prix d’or ur des décennies les productions des industriels de l’éolien et du solaire, mais qui impliquerait selon certain encore une inflation de la facture électrique des citoyens et entreprises.
Ce passage en force qui ne s’est pas encore fait montre toutefois un rapport particulier à la démocratie des politiques français du camp dit de la raison; sans parler de suspicion de conflits d’intérêts de certains membres du gouvernement [(1)Le Figaro 13 juillet / (2)Le Monde 19 juillet]. Ces éléments, plus la situation politique instable de la France à l’heure actuelle ne me rend pas optimiste sur la possibilité de renouer avec une politique énergétique claire, ambitieuse et tournée vers les intérêts de français.
Cette politique que j’appelle de mes vœux, repose sur 3 piliers :
-
un investissement massif dans le nucléaire : EPR nouvelle génération, micro-centrales, surgénérateur et fusion,
-
des investissements massifs dans les ENR pilotables avec des chantiers ambitieux pour construire de nouveaux barrages hydo-électrique (production ou de stockage), mais aussi des centrales hydro-électriques maritimes.
-
La création de fonds souverains afin de permettre les investissements nécessaires pour l’entretien et le renforcement de nos capacités. Cette création pourrait se faire dans le cadre d’un fonds de pension français, permettant de faire d’une pierre 2 coups, apporter de la capitalisation au système de retraites français et permettre que cette dette soit détenue par des français, diminuant la dépendance de la dette française par des investisseurs étrangers.
Nous disposons des ingénieurs et des capacités de construction locales ; mobiliser ces atouts renforcera l’économie et la réindustrialisation de nos territoires, consolidant notre autonomie stratégique. En parallèle, il paraît judicieux de réduire les investissements dans l’éolien et le solaire, dont la chaîne de valeur est largement extra‑territoriale et donc contraire à notre objectif de souveraineté.
Je crains qu’hélas se désir ne reste qu’un vœu pieux et qu’il est peu probable de retrouver des hommes ou femmes politiques qui auraient ce courage et cette vision. Il est temps que les citoyens, la société civile se mobilisent pour faire pression sur leurs députés afin d’obtenir notamment la mise en place de ce fonds souverain qui est d’une nécessité criante.
Il existe une lueur d’espoir dans une initiative que d’aucun qualifieront de populiste, celle des « Gueux » porté par l’écrivain Alexandre Jardin (Livre « Les Gueux – 2025). Des initiatives combattantes sont menées notamment contre les éoliennes [vent de colère] et la résistance contre la PPE avec des contre-propositions [Piebîem webnode]. Ces initiatives sont suivies par la presse avec plus [Le Figaro] ou moins de bienveillance [Ouest-France].
Emmanuel MAWET
Réagissez, commentez !
- Aucun commentaire pour l'instant